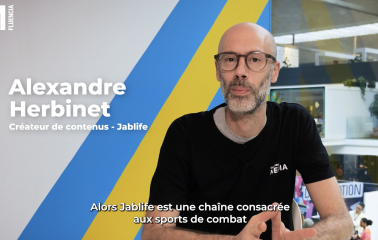S'identifier
espace abonné
Mon compte
Abonné.e