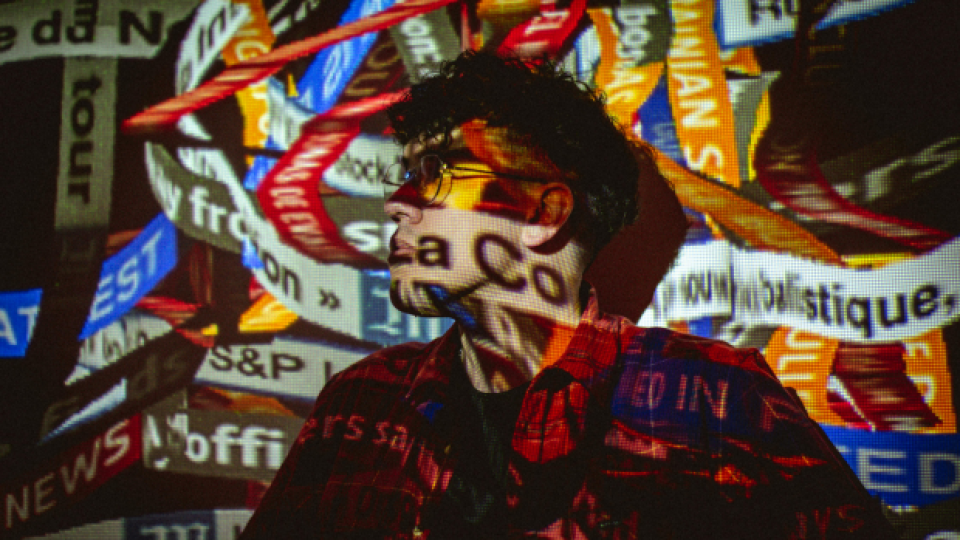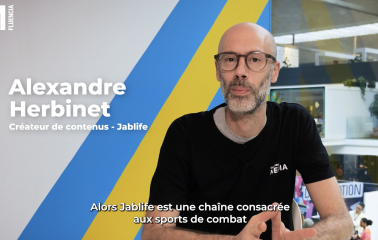Bienvenue dans l’ère de la Médiamorphose
Les médias se transforment, nos rapports à l’information aussi. À l’ère de la défiance et de la surconsommation frénétique, Médiamorphose s’ouvre pour explorer les nouvelles règles médiatiques à travers une série de plusieurs articles pour décrypter ces bouleversements et mieux comprendre leurs conséquences, et un événement organisé par INfluencia Media Event le 21 mai 2025 au George V à Paris. Un rendez-vous pour penser la métamorphose en cours.
En partenariat avec l’agence UM et MédiaFigaro
Les médias ne sont plus une culture commune. Le rite domestique acquis au XXe siècle, qui voyait le père de famille plongé dans son journal quotidien à l’heure du petit-déjeuner, la famille se réunir autour de la table à l’occasion du JT de 20 heures, écouter la radio dans la voiture familiale ou communier autour du film du dimanche soir n’ont plus cours. Les médias se révèlent désormais plutôt des marqueurs de générations où chacun développe ses propres usages. Une divergence qui nourrit un certain nombre d’idées reçues sur le supposé désintérêt des jeunes vis-à-vis de l’information et leur prétendue perméabilité aux contenus nocifs. Le baromètre 2024 La Croix Verian La Poste[1] vient au secours des idées reçues, en rappelant que 74% des 18-24 ans déclarent suivre l’actualité avec un grand intérêt. L’envie d’information ne se tarit pas. C’est la manière d’y accéder qui marque le changement des relations avec les médias.
Ubiquité et gratuité : la nouvelle règle du jeu
Selon une étude Mediametrie[2], les moins de 25 ans passent 3h50 par jour sur internet, dont 3h34 sur leur téléphone mobile. Et selon le baromètre La Croix Verian La Poste, 54% de cette même population déclare faire un usage quotidien des réseaux sociaux pour s’informer. Difficile, compte tenu de ces chiffres, d’affirmer une quelconque désertion des médias par les plus jeunes. L’accès aux contenus se fait désormais de manière continue et parcellaire. Une autre ambiguïté à résoudre, notamment celle liée à la fidélité pour des médias soumis à une logique de flux et aux bons vouloirs des plateformes, qui constituent désormais les principales portes d’entrée à l’information. La qualité de l’émetteur compte, à ce titre, souvent moins que le canal donnant accès à l’information. « Ce que nous ont appris les algorithmes de recommandation, c’est que l’information doit répondre à un besoin, une utilité si elle veut être trouvée » rappelle Nicolas Becquet, journaliste et manager du pôle digital du quotidien belge l’Echo.Le contexte économique est aussi essentiel pour comprendre ces nouvelles relations. Selon une étude de l’Arcom[3], seuls 39% des Français payent pour accéder à l’information. Cette ère de quasi-gratuité des contenus ouverte par le numérique change évidemment radicalement la relation que nous pouvons avoir avec les médias. Pour être achetée de manière durable, une information doit en permanence être en capacité de démontrer sa valeur ajoutée. Une situation qui conduit à la précarisation des médias et à leur grande dépendance aux plateformes de contenus.
Qu’est-ce qu’un média au XXIe siècle ?
Comprendre ces nouveaux rapports conduit à questionner le principe même de média. S’il était simple d’en définir les contours et les influences lorsque l’information était structurée par quelques titres de presse et autant de rendez-vous réguliers, il devient plus difficile de le faire à une époque où l’information se fait plus diffuse. « Le média va bien au-delà des journaux ou de la télévision traditionnels. Il inclut les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, les podcasts, et même les individus qui partagent du contenu » rappelle Alexandra Klinnik, journaliste média et innovation à France Télévisions. « Un média est à la fois un canal d’information et un espace où les opinions, les cultures et les idées se rencontrent ». Dans ce cadre, la première erreur serait de considérer le périmètre médiatique comme un univers homogène. Chercher à définir « les médias » apparaît aussi incongru que chercher à fusionner la ligne éditoriale de TF1 avec celle de Mediapart ou d’HugoDécrypte. L’univers des médias est aussi composite que celui des idées qu’il porte et il faut en tenir compte lorsqu’on cherche à en définir les contours. La seconde erreur serait d’imaginer que la concurrence continue à se faire aujourd’hui entre les grands médias constitués, comme le sont le Monde, FranceTV ou encore Europe1. A une époque où l’information se consulte pour près de 70% sur mobile[4] et près de 39% du temps passé en ligne se fait sur les réseaux sociaux[5], où 53% des Français partagent des informations sans prendre le soin d’en connaître la source[6], la concurrence se fait désormais entre les canaux de diffusion plutôt qu’entre les titres eux-mêmes. À ce titre, l’entêtement des plateformes à refuser d’être considérées comme des médias pour éviter d’en endosser les responsabilités ne tient pas face aux usages. Un média est aujourd’hui tout autant une chaîne de télévision à qui on a officiellement attribué une fréquence de diffusion qu’un créateur anonyme qui propose du contenu sur sa chaîne Youtube ou son fil TikTok.
Le « grand mix »
Un média n’est donc pas plus un support qu’un tuyau ou un rituel. C’est un peu tout ça à la fois. Ce que Bruno Patino, Président d’Arte et observateur attentif de la transformation des médias, qualifie de « grand mix », c’est-à-dire la fin d’une information structurée et relayée par des canaux définis au profit d’un vaste espace où se mélangent contextes, profils et contenus. « Avant l’essor des réseaux sociaux, chaque univers médiatique avait son code de conversation. Aujourd’hui, l’opinion, l’information sérieuse et la désinformation se retrouvent mélangés et gérés par les algorithmes ; il n’y a plus aucune hiérarchisation ni distinction des contenus »[7]. Ce « grand mix » conduit désormais à abattre définitivement les cloisons entre programmes, plateformes, canaux, supports de diffusion ou même le contexte dans lequel l’information nous parvient. « Je trouve ça bien de mixer les gens de la « télévision couleur » et des gens d’Internet » confessait fin octobre 2024 la journaliste Elise Lucet pour le lancement de sa chaîne « Derush » sur Youtube, recevant pour l’occasion le créateur de contenus Squeezy. Une manière de capter deux audiences pour deux générations de médias. « Il faut abattre les frontières : il est temps » complétait-elle. L’offre doit par conséquent ratisser large pour se faire entendre. Multiplier les formats et les canaux. Pas toujours idéal pour assurer la cohérence d’une ligne éditoriale.
Prochain épisode : nouveaux médias : mélange des genres ?
[1] Baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé par l’institut Verian pour La Croix – Janvier 2025
[2] « Les 15-24 ans : des pratiques médias intensives, individuelles et connectées » – Mediametrie – 30/04/2024
[3] Les Français et l’information – Mars 2024 –
[4] Reuters Institute 2024
[5] L’année Internet 2023 – Médiametrie – Février 2024 –
[6] « Les Français et les fake news » – Sondage BVA pour la Villa Numeris – Avril 2018 –
[7] S’informer à l’heure des réseaux sociaux – Vie Publique – Bruno Patino – novembre 2023 –