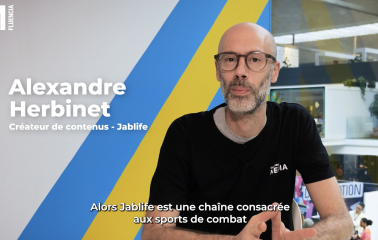INfluencia : Comment qualifieriez-vous la relation entre le Président Trump et les médias ?
Christophe Lachnitt : Cette relation est à la fois singulière et plurielle. Singulière, parce que, jamais dans l’histoire américaine, voire mondiale, un dirigeant politique n’a autant fondé sa conquête et son exercice du pouvoir sur les médias. Plurielle parce que cette symbiose entre Donald Trump et les médias couvre toutes les phases de son parcours politique, de l’émergence à la gouvernance.
En premier lieu, la crédibilité de Donald Trump repose, à un niveau que l’on a parfois du mal à envisager en France, sur “The Apprentice“, l’émission de téléréalité dans laquelle il incarnait un ponte du business mentorant des candidats qui concouraient pour gagner le privilège de pouvoir travailler dans l’une de ses entreprises. Cette émission, que Donald Trump personnifia pendant quatorze saisons de 2008 à 2015, lui façonna une image de génial entrepreneur, alors même que ses entreprises avaient connu au total six faillites. La perception qu’une partie des Américains ont de lui est donc fondée sur un mensonge, lequel témoigne, une nouvelle fois, de la force – et de la farce – de la télévision.
Deuxième phase de la relation symbiotique entre Donald Trump et les médias, les administrations Trump I et, plus encore, Trump II ont été composées non pas en fonction de la compétence des impétrants, mais, outre leur loyauté sans faille, de leur talent médiatique et, plus précisément encore, de l’allure qu’ils projettent en raison de leur look (apparence physique et style vestimentaire). Donald Trump choisit ses collaborateurs comme un directeur de casting de cinéma ou, on y revient, de téléréalité.
La perception qu’une partie des Américains ont de lui est donc fondée sur un mensonge, lequel témoigne, une nouvelle fois, de la force – et de la farce – de la télévision.
C’est ainsi, par exemple, que l’ancien combattant Pete Hegseth se retrouve sans aucune expérience managériale, en tant que secrétaire à la Défense, à la tête de la plus grande administration américaine, qui emploie trois millions de personnes. Ses seuls mérites sont d’avoir coanimé l’émission matinale des week-ends de Fox News et de porter beau. Il s’est rapidement distingué par ses inepties managériales, la plus retentissante étant le scandale du “Signalgate“, c’est-à-dire la révélation de plans militaires secret défense dans une conversation sur l’application Signal dans laquelle avait été invité par erreur un journaliste. Pete Hegseth réagit d’abord en mentant au sujet de ce qui avait été discuté dans cette conversation – alors qu’il fut facile pour le journaliste de le contredire, preuves à l’appui – puis en accusant ledit journaliste, l’un des plus respectés de Washington, d’être peu ou prou un ennemi de l’Amérique. Il fut ensuite révélé qu’il partageait d’autres informations militaires sensibles sur une autre boucle Signal avec, cette fois, des membres de sa famille. Mais il a l’immense mérite d’avoir donné l’ordre d’installer un studio de maquillage tout près de son bureau au Pentagone pour optimiser son apparence lors de ses interventions médiatiques.
Pete Hegseth n’est pas le seul transfuge de Fox News vers l’administration Trump : à ce jour, celle-ci a recruté pas moins de 23 présentateurs et commentateurs de la chaîne. Ce n’est pas un gouvernement, c’est un talk-show. La relation opère d’ailleurs dans les deux sens : les membres-clés de l’administration Trump sont apparus 500 fois sur Fox News au cours des cent premiers jours du mandat débuté le 20 janvier dernier.
Toute sa gouvernance est conduite, à un niveau sans précédent, pour son impact médiatique (…). C’est une administration narrative.
IN. : Quelle est la troisième phase de la relation intime entre Donald Trump et les médias ?
C.L : La troisième phase, après l’accession au pouvoir et la composition de son équipe, relève de la gouvernance. Vous savez, on dit que Red Bull est une entreprise de production de contenus qui se trouve vendre des boissons énergisantes. Je considère, de même, que la présidence Trump est une opération médiatique qui se trouve gouverner la première puissance mondiale. Toute sa gouvernance est conduite, à un niveau sans précédent, pour son impact médiatique. Ce n’est plus seulement de la communication performative, comme dans le cas de beaucoup d’exécutifs. C’est ici une administration narrative.
L’exemple à la fois le plus abouti et le plus abject concerne Kristi Noem, la secrétaire à la Sécurité intérieure. Elle a transformé ses comptes sur les réseaux sociaux en mini-émissions de téléréalité, qui s’inspirent également de l’esthétique des séries télévisées, au cours desquelles elle se met en scène, et invite des TikTokers à assister et relayer des opérations d’arrestation d’immigrés illégaux.
Le symbole de son action et de sa communication est une photo que Kristi Noem a publié pour rendre compte de sa visite dans la prison – je devrais plutôt dire le goulag – d’El Salvador où sont emprisonnés les pires délinquants du pays et des personnes que l’administration Trump y envoie sans justification légale. Sur cette photo, on la voit poser devant un quasi-empilage de prisonniers torses nus dont l’indigence est censée contraster avec sa propre mise en beauté. Il est difficile de ne pas y voir une référence, aux relents nauséabonds, à l’existence de deux catégories de personnes humaines.
Face à ce tsunami quotidien, les médias d’information, que j’oppose aux médias de propagande, sont déboussolés, ce qui est l’objectif.
IN. : Depuis son arrivée au pouvoir, le Président multiplie les annonces imprévisibles et provocatrices. Comment les grands médias américains gèrent-ils ce flot constant d’informations ? Et comment se positionnent-ils face à une situation politique inédite ?
C.L : Vous avez raison de souligner le volume d’informations émises par Donald Trump. Il est le prince noir du chaos informationnel. Il applique en cela la stratégie de communication théorisée par Steve Bannon, son stratège en chef durant son premier mandat, consistant à “submerger l’espace médiatique de merde” (sic) afin de noyer les médias, qui ne savent pas sur quoi se concentrer ni comment hiérarchiser les informations, et, partant, de désorienter le peuple. Au début du second mandat de Donald Trump, le même Bannon s’est enorgueilli du succès de sa stratégie, en soulignant qu’il était stupéfait de voir ce que l’administration Trump pouvait faire sans que cela soit couvert parce que le système médiatique est submergé. Toujours à propos de Steve Bannon, rappelons l’un de ses autres préceptes en cours d’application : “Tout est média. Les médias sont le message, et Trump le comprend. C’est la raison pour laquelle le cabinet ne compte que des hommes de télévision. Ce qui se passe sur MSNBC en ce moment est plus réel que ce qui se passe dans la vraie vie, dans le monde analogique”.
Face à ce tsunami quotidien, les médias d’information, que j’oppose aux médias de propagande, sont déboussolés, ce qui est l’objectif. Primo, ils ne peuvent pas tout couvrir au même niveau. Rendez-vous compte que, sur certaines périodes, The New York Times publie en moyenne de nouveaux contenus sur Donald Trump toutes les demi-heures ! Secundo, ils ont toujours tendance, comme lors du premier mandat de Donald Trump, à privilégier le sensationnel sur l’essentiel.
La concurrence de médias numériques gratuits les bride-t-elle trop ? La précarisation des rédactions les a-t-elle rendues vulnérables à l’agenda frénétique imposé par le pouvoir ? Les médias d’information se méprennent-ils sur la demande de leurs concitoyens ? La domination médiatique des flux et le formatage algorithmique – éditorial et temporel – les empêchent-ils de produire du sens ? La crainte d’apparaître partisans et/ou la peur des menaces quotidiennes et des procès de Donald Trump les paralysent-elles dans leur mission critique ? Ont-ils renoncé à leur rôle de quatrième pouvoir ? Il est difficile, naturellement, d’évaluer la part de ces différents facteurs dans ce que nous observons aujourd’hui outre-Atlantique.
Les médias aident Donald Trump en étant défaillants sur leur mission civique.
Toujours est-il que les médias aident Donald Trump en étant défaillants sur leur mission civique. On n’a pas l’impression, à lire, écouter et regarder les grands médias d’information américains, que les Etats-Unis traversent une crise démocratique sans précédent, et que l’administration Trump éloigne plus ou moins sensiblement l’Amérique de la démocratie. Pour les médias américains, c’est encore “business as usual“. Même les manifestations anti-Trump qui ont parcouru une grande partie du pays début avril – plus d’un millier de rassemblements au total dans les cinquante Etats – ont davantage été mises en exergue par la presse européenne que par les journaux américains. En réalité, beaucoup de catastrophes naturelles suscitent outre-Atlantique une couverture médiatique plus intense que la catastrophe institutionnelle actuelle. Honnêtement, cela dépasse l’entendement.
Les propriétaires ou maisons-mères de plusieurs grands médias d’information semblent avoir capitulé devant Donald Trump.
Au-delà des éléments évoqués interrogativement à l’instant, qui contribuent tous à la situation que nous constatons, il me semble qu’il y a deux facteurs aggravants.
Tout d’abord, les propriétaires ou maisons-mères de plusieurs grands médias d’information semblent avoir capitulé devant Donald Trump. C’est le cas par exemple de Jeff Bezos pour Amazon Prime (versement de 40 millions de dollars à Melania Trump pour la réalisation d’un documentaire sur elle) et The Washington Post (limitation des opinions exprimées dans le journal), de CNN (exfiltration forcée de Jim Acosta, l’un des journalistes les plus honnis par Donald Trump), de Comcast pour MSNBC (annulation de l’émission de Joy Reid, elle aussi détestée par Donald Trump), de Disney (diffusion de la chaîne conspirationniste d’extrême-droite Newsmax sur le service Hulu+Live TV et versement de 15 millions de dollars à Donald Trump pour éviter le procès absurde intenté à ABC News), de Shari Redstone pour CBS News (négociation avec Donald Trump sur son procès, tout aussi absurde, intenté contre l’émission “60 Minutes“, pression éditoriale sur celle-ci et départ de Bill Owens, son producteur iconique) et de Patrick Soon-Shiong pour The Los Angeles Times (virage à 180 degrés vers un soutien à Donald Trump).
Il n’y a plus, outre-Atlantique, de grandes voix journalistiques dont la crédibilité dépasse les clivages partisans.
Ensuite, il n’y a plus, outre-Atlantique, de grandes voix journalistiques dont la crédibilité dépasse les clivages partisans, comme purent l’être Edward R. Murrow face à Joseph McCarthy ou Walter Conkrite face à Richard Nixon. Mais il faut reconnaître que Joseph McCarthy ne détenait pas de pouvoir exécutif et que, malgré toutes ses transgressions, Richard Nixon n’a jamais utilisé celui-ci contre ses opposants à la manière de Donald Trump.
Les médias d’information pourraient redonner aux journalistes leur rôle civique.
IN. : Dans ce contexte, que devraient faire les médias d’information américains ?
C.L : Il est plus facile de répondre à cette question dans ma situation que dans la leur. Cela étant dit, comme l’ont souligné successivement saint Luc et Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Les propriétaires, dirigeants et salariés des médias d’information américains pourraient d’abord prendre conscience de la gravité de la situation. Hannah Arendt expliquait que l’incapacité d’une Société à imaginer la perte de ses libertés, en particulier après une longue période démocratique, peut résulter dans une inconscience de la montée rampante de l’autoritarisme. Ce manque d’imagination, à la fois chez les dirigeants et chez les citoyens, facilite le glissement progressif vers la dictature.
Ensuite, les médias d’information pourraient remettre en cause cinq de leurs pratiques actuelles. Il ne s’agirait pas de réduire la liberté d’expression, et ce d’autant moins qu’elle est largement assurée, sans filtre, sur les plates-formes numériques, mais de redonner aux journalistes leur rôle civique.
La deuxième pratique résiderait dans le fait de ne pas ouvrir leurs antennes à des politiciens simplement parce que les controverses qu’ils génèrent font de l’audience.
La première consisterait à arrêter de traiter le Parti républicain comme un organe responsable et respectable. De fait, la grille de lecture traditionnelle de la politique américaine ne tient plus aujourd’hui et son application persistante est le meilleur service rendu aux ennemis de la liberté. A cet égard, une première mesure devrait consister à interdire d’antennes et de colonnes tous les politiciens qui n’ont pas reconnu publiquement la légalité et la légitimité de la victoire de Joe Biden en 2020. En continuant de leur tendre leurs micros, les médias se font les complices de leurs mensonges.
La deuxième résiderait dans le fait de ne pas ouvrir leurs antennes à des politiciens simplement parce que les controverses qu’ils génèrent font de l’audience. Est-ce encore une évidence de rappeler que le travail journalistique ne consiste pas seulement à relater les informations, mais aussi à les hiérarchiser, les contextualiser et les expliquer ?
La troisième évolution consisterait à s’unir, au quotidien, pour obtenir des réponses aux questions légitimes auxquelles les candidats et élus devraient répondre.
La troisième évolution consisterait à s’unir, au quotidien, pour obtenir des réponses aux questions légitimes auxquelles les candidats et élus devraient répondre. Lors du premier mandat de Donald Trump, j’avais relaté à cet égard, sur Superception, un exemple hollandais qui m’inspire encore : Peter Hoekstra, l’ambassadeur nommé par Donald Trump aux Pays-Bas, donna une conférence de presse et fut interrogé sur des déclarations qu’il avait faites trois ans plus tôt dans lesquelles il affirmait que le mouvement islamiste avait créé un chaos dans le pays, que des hommes politiques étaient brûlés vifs et qu’il existait des zones de non-droit. Lors de sa première intervention devant la presse, il fut interrogé sur ses déclarations, et refusa de les commenter ou de donner des exemples confirmant leur prétendue exactitude. Les journalistes mirent alors de côté leur concurrence pour s’allier afin d’obtenir une réponse de l’ambassadeur, chacun rebondissant sur la question du précédent à ce même sujet.
Les médias devraient moins challenger les extrémistes sur les valeurs et davantage les confronter aux faits.
Quatrièmement, les médias devraient moins challenger les extrémistes sur les valeurs et davantage les confronter aux faits. Dans ce domaine, l’exposition par le regretté Tim Russert de la vacuité des arguments de David Duke, ancien leader du Klu Klux Klan et toujours suprémaciste blanc, lorsqu’il se présenta au poste de gouverneur de l’Etat de Louisiane en 1991, dans une extraordinaire interview est un modèle du genre. Lorsqu’on débat avec des extrémistes de leur credo, on joue leur jeu car ils peuvent s’en tirer avec des généralités idéologiques. C’est lorsqu’on les confronte à des faits qu’ils sont plus en danger.
Les médias d’information pourraient la (éducation civique) réaliser au quotidien, dans leur couverture de l’actualité, par exemple en faisant la pédagogie des principes constitutionnels que Donald Trump tente de violer.
Last but not least, je considère que les médias d’information ont un formidable rôle à jouer en matière d’éducation civique. Ils pourraient la réaliser au quotidien, dans leur couverture de l’actualité, par exemple en faisant la pédagogie des principes constitutionnels que Donald Trump tente de violer. Ou, pour prendre ses derniers stratagèmes en date de distraction des vrais enjeux, ils pourraient mettre en perspective les coûts respectifs de la transformation d’un musée (Alcatraz) en prison et de l’organisation d’une parade militaire à Washington DC le jour de son anniversaire, le 14 juin prochain. Ils pourraient aussi dédier des émissions spéciales à cette pédagogie. Ainsi, dans les années 1960, Walter Conkrite consacra-t-il, sur CBS News, trois émissions aux connaissances que les citoyens devraient maîtriser, lesquelles prirent la forme de tests de connaissance ludiques. Cette série comprit notamment une émission, “The National Citizenship Test“, qui proposa aux téléspectateurs de répondre à 42 questions sur les droits et les responsabilités des citoyens. Bien sûr, la consommation médiatique a évolué depuis lors, mais la télévision américaine est maîtresse dans l’art de produire des jeux télévisés sur tout et n’importe quoi. Alors pourquoi pas sur la politique ?
Tout ceci est naturellement un peu utopique et plus facile à suggérer qu’à réaliser. Mais je n’ai pas l’impression que les médias d’information américains soient passés en mode crise, qu’ils soient prêts à briser leurs schémas établis pour faire face à une situation exceptionnelle.
Il y a les récriminations et menaces quasi quotidiennes que Donald Trump profère sur son réseau Truth Social, en soi un oxymore.
IN. : Justement, les médias américains font l’objet de beaucoup de menaces et de pressions.
C.L : En effet. Il y a d’abord les récriminations et menaces quasi quotidiennes que Donald Trump profère sur son réseau Truth Social, en soi un oxymore, lesquelles peuvent générer de la violence verbale, voire physique, à l’égard des journalistes contre lesquels la meute de ses supporters les plus fanatiques est lâchée sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Il y a ensuite les procès qu’il intente à des organisations médiatiques (ABC News, CBS News, Gannett, The Des Moines Register et The Pulitzer Center). Il y a surtout les menaces gouvernementales, qui contreviennent le plus souvent à la séparation des pouvoirs. Le premier exécuteur de ces basses œuvres est Brendan Carr, la personne nommée par Donald Trump à la tête de la FCC (Federal Communications Commission), l’instance de régulation des médias audiovisuels et numériques, qui est indépendante du gouvernement. Sans vergogne, Brendan Carr mène cependant une campagne d’intimidation à l’égard des médias qui déplaisent au Président, en lançant des enquêtes sur leurs initiatives en matière de diversité et d’inclusion (Comcast), au sujet de leur couverture des élections (ABC, CBS et NBC) ou à propos de leurs pratiques publicitaires (NPR et PBS), et ce alors même qu’il ferme complaisamment les yeux sur tous les excès des médias d’extrême-droite qui soutiennent le Président. Sentant le danger, Disney, Paramount et Warner Bros. Discovery ont annoncé à titre préventif qu’ils mettraient fin ou réduiraient leurs programmes de diversité.
Quant aux principales plates-formes numériques, elles ont toutes, de Meta à TikTok en passant par Alphabet et Apple, fait en sorte de s’attirer les bonnes grâces du Président. Mark Zuckerberg a effectué le virage le plus spectaculaire en renonçant du jour au lendemain à tout ce qu’il promouvait pour adopter des politiques pro-MAGA en matière de modération de contenus et de diversité.
Plus globalement, les groupes de médias ont peur ou ont besoin de Donald Trump : les groupes numériques en matière de régulation, notamment sur l’intelligence artificielle (Donald Trump vient d’ailleurs de licencier le directeur du Bureau des droits d’auteur qui s’inquiétait de l’entraînement de modèles à partir de contenus protégés), Paramount pour sa fusion avec Skydance Media, Jeff Bezos pour le procès accusant Amazon d’être un monopole et pour les contrats de Blue Origin, etc.
Quant aux médias publics, ils ne sont pas mieux lotis : Donald Trump a licencié des dirigeants de The Corporation for Public Broadcasting, et a ordonné au Groupe de cesser de financer NPR et PBS. Dans les deux cas, ces décisions ne relèvent pas de son champ de responsabilités.
L’équipe de Donald Trump voulait ouvrir la Maison-Blanche à de “nouveaux médias“. (…) Ils se livrent à des exercices de servilité qui, honnêtement, constituent, au sein même de la Maison-Blanche, une insulte à la démocratie américaine.
IN. : Certains médias ont été exclus de briefings. Comment les médias américains ont-ils réagi ?
C. L : En effet, l’administration Trump a pris le contrôle du pool de presse de la Maison-Blanche dans une démarche sans précédent qui voit le gouvernement fédéral déterminer quels organes de presse ont accès au Président. Or c’est l’Association des correspondants de la Maison-Blanche (WHCA), créée en 1914 et démocratiquement élue par lesdits correspondants, qui décide de l’accès de la presse aux installations de la Maison-Blanche et d’Air Force One, et qui est responsable de l’organisation du pool de presse rotatif qui couvre les événements où l’espace est limité.
L’équipe de Donald Trump a justifié sa décision en affirmant que c’était un privilège, et non un droit, d’avoir accès au Président – exactement l’inverse d’un principe démocratique – et qu’elle voulait ouvrir la Maison-Blanche à de “nouveaux médias“, qui se sont révélés être essentiellement des panégyristes du locataire du Bureau ovale. Ils se livrent à des exercices de servilité qui, honnêtement, constituent, au sein même de la Maison-Blanche, une insulte à la démocratie américaine. Pour ne considérer qu’un exemple, un podcaster nommé Tim Pool, choisi par l’équipe presse de Donald Trump pour remplacer un journaliste, a utilisé son temps de parole pour dénigrer la presse, oubliant de rappeler qu’il avait indirectement touché plusieurs centaines de milliers de dollars de la Russie pour devenir l’un de ses propagandistes durant l’élection présidentielle américaine de 2024. Une autre fois, une session réservée à ces “nouveaux médias“ rassembla un humoriste, un créateur de mèmes, un Instagrammer, l’ancien joueur de banjo du groupe Mumford & Sons, et une influenceuse qui affirmait récemment sur X avoir cherché la Lune pendant sept jours et avoir pensé qu’elle avait disparue. Cette dernière compte plus de 625 000 abonnés à son compte sur X. Notons cependant que la stratégie de la Maison-Blanche de remplacer des journalistes par des influenceurs n’a pas porté ses fruits en ligne car la flatterie n’est pas virale.
On sait combien l’ego de Donald Trump souffrirait s’il faisait l’objet d’un boycott d’une presse dont il cherche tant l’assentiment, même s’il la critique continûment.
IN. : La Maison-Blanche a aussi empêché The Associated Press de participer à ses événements dédiés à la presse.
C.L : Oui, la raison invoquée est le refus de l’agence de presse d’utiliser l’expression que Donald Trump veut imposer pour rebaptiser le Golfe du Mexique en “Golfe de l’Amérique“. Le message est clair : déplaisez au Président et vous serez punis. Certes, la punition est professionnelle et non léthale comme sous Vladimir Poutine, mais elle augure mal de l’évolution de la république américaine sous Donald Trump. Certes, d’autres Présidents, y compris récemment George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden, ont voulu punir des organes de presse, mais lesdites punitions ont été vexatoires et non attentatoires.
Sans surprise si l’on considère leur comportement durant le premier mandat de Donald Trump, les médias d’information ont accepté le nouveau fonctionnement instauré par la Maison-Blanche concernant le pool et n’ont déployé aucune action mutualisée pour lui résister. Ils n’ont pas davantage cherché à faire montre de solidarité avec The Associated Press. Pourtant, on sait combien l’ego de Donald Trump souffrirait s’il faisait l’objet d’un boycott d’une presse dont il cherche tant l’assentiment, même s’il la critique continûment. Il fut d’ailleurs intéressant de constater que Donald Trump, pour le bilan de ses cent jours, et Elon Musk, pour l’annonce de son retrait de DOGE, convoquèrent tous deux les médias d’information qu’ils insultent à longueur d’année : ABC News, NBC News et The Atlantic (qui avait pourtant révélé le “Signalgate“) pour le premier, ABC News, NBC News, The Associated Press (malgré le Golfe du Mexique), The New York Times et The Washington Post pour le second. Lorsque les choses deviennent sérieuses, il semble que Joe Rogan et Theo Von ne suffisent plus.
Les organes d’information ont donc largement capitulé. Pour prendre conscience de cette réalité, revenons au Golfe du Mexique : lors de l’amerrissage des astronautes américains restés bloqués à bord de la Station spatiale internationale pendant plus de neuf mois, les journalistes des grandes chaînes de télévision employèrent des détours sémantiques pour ne prononcer aucune des deux formulations – “Golfe du Mexique“ et “Golfe de l’Amérique“ –, et certains se corrigèrent même après avoir évoqué le Golfe du Mexique.
En outre, les géants du numérique, censés être les entreprises les plus puissantes au monde, ne furent pas plus hardies que les grandes chaînes de télévision. Google changea le nom du Golfe sur Google Maps aux Etats-Unis en “Golfe de l’Amérique“, ce qui lui cause des soucis avec le Mexique qui vient de le poursuivre en justice. Google Maps utilise le nom consacré au Mexique et mentionne les deux noms dans le reste du monde. Apple, l’entreprise la plus valorisée au monde, s’est aussi pliée au diktat orwellien de Donald Trump, en adoptant la même approche que celle de Google. Le courage n’est donc proportionnel ni à la taille des enjeux concernés ni aux moyens financiers à sa disposition.
Résultat : le Golfe du Mexique est désormais traité sur les cartes américaines avec la même soumission au pouvoir que Taiwan l’est sur les cartes chinoises – où l’île est une province de l’empire du Milieu et non un Etat indépendant. Je ne suis pas sûr que ce soit une référence dont l’on puisse se féliciter pour nos amis américains. Surtout, en l’emportant sur cette dénomination, Donald Trump a testé la résolution des médias et sait désormais qu’il peut aller plus loin. Il va continuer de la tester jusqu’à ce qu’il trouve une vraie résistance.
Je voudrais terminer en mettant en exergue une remarquable exception au renoncement de nombre de médias américains. Il s’agit de The Atlantic, fondé au milieu du 19ème siècle et aujourd’hui détenu majoritairement par Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. Elle dirige cette institution du journalisme américain, qui, dernièrement, a notamment révélé le “Signalgate“, avec une exemplaire intégrité, peut-être parce qu’elle ne pâtit d’aucun conflit d’intérêts.
Les médias d’information ont poursuivi, voire accentué, la stratégie de normalisation (…) qui passe notamment par la présentation de plus en plus équilibrée des points de vue des deux camps (…). Cette approche fournit une caisse de résonance, à des idées et mensonges qui devraient être cantonnés aux médias de propagande.
IN. : Quelles stratégies les médias américains adoptent-ils pour couvrir des affirmations fausses ou manipulatoires sans les amplifier ?
C.L : Il convient de faire la différence entre les médias de propagande, dont Fox News – que j’appelle Faux News – est l’incarnation la plus populaire, et les médias d’information. Les premiers amplifient la désinformation à des fins de monétisation. Les seconds ont une tâche infiniment plus complexe.
En premier lieu, leur travail, du reste très inégal, en matière de fact checking est d’autant plus ardu que plusieurs études ont montré que la vérification de faits affirmés par des politiciens peut renforcer de fausses croyances chez leurs supporters, que ce soit dans des médias traditionnels ou sur des médias sociaux.
Plus globalement, il me semble que les médias d’information ont, après la deuxième élection de Donald Trump, considéré qu’ils ne pouvaient pas rejeter un mouvement politique dont le messager s’était à nouveau fait élire à la Maison-Blanche et, cette fois, en gagnant le vote populaire (même si avec une marge beaucoup moins importante que ce qu’il proclame). Ils ont donc poursuivi, voire accentué, la stratégie de normalisation qu’ils avaient mise en œuvre une fois le traumatisme du 6 janvier digéré. Cette stratégie passe notamment par la présentation de plus en plus équilibrée des points de vue des deux camps, alors même que l’un d’eux est de plus en plus antidémocratique et anti-républicain. Cette approche fournit une caisse de résonance, sur les médias d’information, à des idées et mensonges qui devraient être cantonnés aux médias de propagande.
La personnification de cette approche s’appelle Scott Jennings. Il est devenu le commentateur politique de droite vedette sur CNN en raison de sa capacité à normaliser les pires idées défendues par Donald Trump, y compris lorsqu’il présente Adolf Hitler en modèle de gouvernance. En réalité, Scott Jennings est davantage un porte-parole du Président, au cours d’un rassemblement duquel il est même récemment intervenu sur scène, qu’un analyste politique. Et il envisage ouvertement de se porter candidat pour succéder à Mitch McConnell comme sénateur du Kentucky. Sa présence à l’antenne vise à présenter CNN comme une chaîne d’information neutre et non un canal d’expression de la gauche américaine à l’instar de MSNBC. Mais, ce faisant, CNN confond objectivité et relativité.
Cette fausse neutralité va désormais jusqu’à faire abstraction des réalités les plus élémentaires dans la couverture des positions des uns et des autres, créant de ce fait une niche de permissivité avec les faits pour le journalisme politique.
IN. : Dans ce contexte, comment les médias d’information pourraient-ils se réinventer pour jouer leur rôle de quatrième pouvoir et défendre la démocratie américaine ?
C.L : Le problème de la vision éditoriale de CNN est que le journalisme est soluble dans l’absence de valeurs. Or, la recherche de l’objectivité journalistique est un exercice de plus en plus périlleux. Les médias qui s’y essaient se font attaquer en permanence par les plus extrémistes des deux camps en présence. Il leur est donc plus aisé d’adopter une fausse neutralité en présentant les points de vue opposés sans les qualifier. Mais c’est une attitude indigne lorsqu’il s’agit soit d’enjeux dans lesquels une partie fonde son argumentation sur des mensonges factuels, soit de discussions sur des sujets indéfendables : aurait-il été pertinent, dans les années 1800, de couvrir les débats sur l’esclavage en donnant la parole aux deux camps sans prendre parti ? Objectivité et intégrité ne sont donc pas synonymes.
Cette fausse neutralité va désormais jusqu’à faire abstraction des réalités les plus élémentaires dans la couverture des positions des uns et des autres, créant de ce fait une niche de permissivité avec les faits pour le journalisme politique. On réprimande à juste titre un reporter lorsqu’il rend compte de manière erronée d’un événement dont il est le témoin : si un correspondant de guerre assiste à un fait A et relate dans son reportage un fait B, il commet une faute professionnelle. Je me demande pourquoi il n’en va pas de même pour leurs collègues qui suivent la vie politique. Si un journaliste entend un candidat à une élection exprimer une affirmation et qu’il relate cette déclaration sans la commenter, alors qu’il sait qu’elle travestit la réalité, ne commet-il pas exactement la même faute professionnelle ? Si un sportif perd un match et qu’il affirme dans la conférence de presse consécutive l’avoir gagné, le journaliste doit-il citer ses propos sans souligner qu’ils sont erronés ? Evidemment pas. C’est pourtant la situation insensée que nous vivons de plus en plus dans le domaine politique, laquelle atteste de la pertinence du précepte énoncé par Jean-François Revel : “L’erreur fuit les faits lorsqu’elle satisfait un besoin“.
Jusqu’à présent, les médias étaient globalement créateurs de consensus, ils sont devenus, avec l’explosion du web social, générateurs de collapsus.
L’une des causes de ce phénomène est que les journalistes sont de moins en moins crédibles pour trier le bon grain de l’ivraie dans le discours politique car les citoyens peuvent désormais s’abreuver à des sources d’information, notamment numériques, qui cèdent à tous leurs caprices idéologiques et émotionnels. De fait, si les plates-formes sociales favorisent l’expression indépendante de toute opinion, elles permettent également la formation, sans aucune restriction, de tribus partisanes, voire de clans dogmatiques. Alors que, jusqu’à présent, les médias étaient globalement créateurs de consensus, ils sont devenus, avec l’explosion du web social, générateurs de collapsus. Partant, de plus en plus de journalistes abdiquent leur devoir de vérification pour préserver leur image de crédibilité. Paradoxalement, l’absence de pertinence factuelle sert l’apparence de crédibilité des journalistes : la neutralité prévaut sur la vérité.
Dans ce cadre, les dirigeants politiques peuvent mentir ouvertement en s’appuyant sur le soutien indéfectible de leurs partisans numériques et les journalistes semblent pris, plus ou moins consciemment, au piège : leur rôle comme arbitres des élégances cognitives est nié par une sphère numérique excessivement polarisée et leur crainte d’une perte d’audience les conduit à renoncer à toute influence réelle. Pourtant, comme l’a dit Bob Woodward, l’un des deux journalistes qui révéla le Watergate, “le journalisme ne relève pas de la sténographie“.
Si les médias sont plus rentables lorsqu’ils s’adressent aux émotions des citoyens, ils sont plus profitables lorsqu’ils font appel à leur raison. Pour paraphraser Laurent Fabius, entre la rentabilité et la profitabilité, il y a le journalisme. C’est son honneur de trouver une voie, de plus en plus étroite, entre la cupidité, indispensable à sa survie, et la responsabilité, indispensable à la nôtre.
Le “Signalgate“ et, surtout, les droits de douane ont peut-être provoqué la fin du renoncement des médias d’information américains.
IN. : Les médias d’information américains parviennent-ils à tracer ce chemin étroit que vous évoquez ?
C.L : Récemment, il me semble qu’il y a eu un pivot, plus ou moins sensible, de leur part à la lumière de deux événements : le “Signalgate“ et l’affaire des droits de douane. La gestion de ces deux dossiers a révélé un tel niveau d’incompétence et, dans le cas du second, a créé de tels risques économiques, pour Wall Street et Main Street, c’est-à-dire sur les marchés boursiers et dans les supermarchés, que les médias ont donné l’impression d’être libérés de leur chimère d’équilibre bipartisan.
Avec les droits de douane en particulier, Donald Trump a quitté le territoire de la bataille culturelle qu’il maîtrise tant pour entrer dans la réalité la plus tangible : les éléments de langage et opérations d’influence n’y suffisent plus. Ce n’est pas un hasard si l’on a vu de premières personnalités républicaines, notamment Ted Cruz, Mitch McConnell et Rand Paul, s’éloigner du Président sur ce sujet : menacer les ressources de leurs électeurs, c’est à terme menacer leur mandat électif. Même les médias du groupe de Rupert Murdoch furent écartelés : alors que Fox News soutint Donald Trump, The Wall Street Journal, de plus en plus fréquemment réservé à propos du Président, critiqua vertement ce dernier sur le fond et la forme, allant jusqu’à souligner qu’il était allé jouer au golf au milieu de la tourmente financière et économique qu’il avait générée.
À cet égard, Jesse Watters, l’un des présentateurs vedettes de Fox News, nota, avec lucidité pour une fois, qu’il aurait éreinté Joe Biden si celui-ci avait joué au golf durant une crise majeure. Incidemment, la sélection par la Maison-Blanche des journalistes et influenceurs qui ont accès au Président que j’évoquais tout à l’heure eut pour conséquence que, lors de son interaction avec eux durant ce funeste week-end, la première question qui fut posée à Donald Trump eut trait à sa performance au golf – il insista qu’il avait gagné un tournoi – et non sur la crise boursière mondiale provoquée par ses droits de douane. S’il était vivant, Alfred Jarry se dirait que, avec Ubu Roi, il manqua d’imagination.
Il se trouve que j’étais aux Etats-Unis autour du “Liberation Day“ et j’ai pu observer ce virage. De même que les médias d’information ne voulaient pas aller à l’encontre de la volonté du peuple d’élire Donald Trump, ils ne peuvent se permettre d’ignorer ses souffrances. Ils se font donc davantage thermomètres que thermostats. Les grands journaux télévisés du soir, par exemple, ont largement traité des risques induits par les droits de douane pour le gagne-pain et les pensions de retraite des Américains moyens. Attention, c’est un virage progressif. Mais c’est une première étape. Le “Signalgate“ et, surtout, les droits de douane ont peut-être provoqué la fin du renoncement des médias d’information américains. Cependant, on est encore très très loin, pour les raisons évoquées tout au long de notre échange, de médias engagés dans la défense de la démocratie américaine.
Le scandale du Watergate porta la confrontation de Richard Nixon avec les médias à son apogée, non seulement dans la salle de presse de la Maison-Blanche, mais aussi de manière plus institutionnelle.
IN. : La présidence Trump marque-t-elle un tournant dans l’histoire des rapports entre pouvoir et médias aux Etats-Unis depuis Richard Nixon ? Si oui, lequel ?
C.L : On peut, sans aucune prétention à la moindre valeur historique de cette analyse, improviser trois grandes périodes à cet égard depuis Richard Nixon, lequel est, incidemment, l’un des personnages les plus captivants, par sa complexité, de l’histoire américaine moderne.
La première, donc, est celle de Richard Nixon, qui eut souvent une relation tendue avec les médias – on se souvient du discours dit de Checkers en 1952 à propos d’une affaire de financement douteuse et du débat télévisé contre John Kennedy en 1960. Cette tension culmina en 1961 dans l’adresse qu’il prononça après avoir perdu l’élection au poste de gouverneur de Californie qui devait lui permettre de rebondir à la suite de sa défaite face à JFK pour la Maison-Blanche. Convaincu que les médias avaient favorisé son adversaire, il leur asséna : “Vous n’aurez plus Nixon à traîner dans la boue, parce que, messieurs, c’est ma dernière conférence de presse“. Il pratiqua alors le droit, et plaida même devant la Cour suprême dans une affaire, qu’il perdit contre le groupe de presse Time et son magazine Life, au centre de laquelle figurait l’équilibre entre liberté d’expression et respect de la vie privée des citoyens.
Parvenu au Bureau ovale, il fit montre d’une méfiance de plus en plus confrontationnelle à l’égard des médias, laquelle fut fameusement incarnée par Ron Ziegler, son intransigeant directeur des relations presse et porte-parole. Le scandale du Watergate porta la confrontation de Richard Nixon avec les médias à son apogée, non seulement dans la salle de presse de la Maison-Blanche, mais aussi de manière plus institutionnelle. En particulier, des journalistes – plus d’une cinquantaine, je crois – figurèrent sur la “liste des ennemis“ qu’il constitua, et certains d’entre eux furent mis sur écoute et firent l’objet de contrôles fiscaux. En outre, des groupes de médias, au premier rang desquels, bien sûr, The Washington Post, furent menacés de représailles financières, juridiques et réglementaires.
Comme la majorité des dirigeants politiques, Jimmy Carter attribua aux médias ses déboires politiques ultérieurs et chercha à contourner les journalistes nationaux de Washington pour s’adresser à la presse des Etats.
Puis, on assista à une phase de transition sans grande signification avec Gerald Ford, qui calma les relations avec la presse sans les normaliser, et Jimmy Carter, qui eut une relation plus compliquée avec les médias, les journalistes, encore marqués par le Watergate, examinant ses propos à la lumière de sa promesse initiale de ne jamais mentir. Comme la majorité des dirigeants politiques, Jimmy Carter attribua aux médias ses déboires politiques ultérieurs et chercha à contourner les journalistes nationaux de Washington pour s’adresser à la presse des Etats.
On peut ensuite estimer que Ronald Reagan, “le grand communicant“, fit entrer la Présidence moderne dans une deuxième époque de relations avec les médias, une phase de maîtrise, notamment incarnée par l’ancien gouverneur de Californie, par Bill Clinton et par Barack Obama, malgré des hauts et des bas dans leurs doubles mandats respectifs. Les deux points communs aux trois Présidents furent leur capacité à mettre la forme au service du fond et leur talent pédagogique. Mais Ronald Reagan se distingua par son optimisme, jusqu’à son message d’adieu à la Nation, Bill Clinton par son empathie, dans sa communication plus que dans sa vie privée, et Barack Obama par sa faculté, jusque dans les crises, d’entrelacer son histoire personnelle et le destin de l’Amérique.
Après les époques de confrontation puis de maîtrise, nous arrivons à l’époque de Donald Trump, que je qualifierai de maîtrise par la confrontation. Pour toutes les raisons évoquées au cours de notre conversation, il antagonise les médias avec beaucoup plus de succès – de son point de vue, pas de celui de l’Amérique – que Richard Nixon. Du reste, sa besogne est facilitée par la défiance dont font preuve les Américains à l’égard des médias d’information, lesquels ont encore aggravé leur cas, juste avant la réélection de Donald Trump, en ignorant le déclin cognitif de Joe Biden, que le pays a seulement découvert lors de son débat avec son rival.
Donald Trump a aussi recours à la désinformation d’une manière que Richard Nixon n’effleura jamais. A cet égard, malgré les 30 573 mensonges du Président Trump, soit plus de 20 par jour, son premier mandat semble presque amateur par rapport à ce que nous voyons depuis le début de son deuxième bail à la Maison-Blanche. Si, à l’époque, son entourage tentait plus souvent qu’à son tour, malgré les “faits alternatifs“ de Kellyanne Conway, de préserver un semblant de crédibilité à l’Administration, aujourd’hui c’est une véritable industrialisation de la désinformation à l’échelle du gouvernement fédéral qui a été mise en place. Et chaque membre de son équipe produit ses propres mensonges.
En plus d’Elon Musk, c’est toute une armée d’influenceurs et de créateurs de contenus qui se consacrent à la promotion des mensonges de l’Administration.
Dans ce système de désinformation, la sphère numérique, qui permet de contourner les médias d’information, joue évidemment un rôle disproportionné et, en son centre, Elon Musk occupe une place prédominante. Ainsi, par exemple, en février dernier, 28 de ses fausses affirmations recueillirent 825 millions de vues sur X en quelques jours. Et, en plus d’Elon Musk, c’est toute une armée d’influenceurs et de créateurs de contenus qui se consacrent à la promotion des mensonges de l’Administration, désormais aidés par la décision de Mark Zuckerberg de confier aux membres respectifs de Facebook, Instagram et Threads la vérification des faits. Il serait impossible pour les médias d’information de lutter contre eux, même s’ils le voulaient vraiment.
Incidemment, la situation factuelle est tellement fluide que Fox Nation – la petite sœur de Fox News proposée en streaming sur abonnement – diffuse désormais un jeu intitulé “What Did I Miss?“, au cours duquel quatre candidats doivent deviner, après trois mois d’isolement, quelles informations sont réelles et lesquelles ne le sont pas.
C’est aussi la première fois qu’un média – Fox News – a autant d’influence sur les décisions d’un Président américain.
Il est aussi évident que Donald Trump dispose d’un écosystème médiatique caractérisé par ce que j’appelle les trois P – pulvérisé, polarisé et participatif – et, au sein de cet écosystème, d’un ensemble de canaux de propagande traditionnels et numériques qui aurait certainement sauvé Richard Nixon lors du Watergate comme il a sauvé Donald Trump après la tentative de coup d’Etat du 6 janvier. En particulier, il entretient une relation, unique dans l’Histoire, avec Fox News, la chaîne d’information câblée la plus populaire outre-Atlantique qui se trouve être un organe de propagande. C’est aussi la première fois qu’un média a autant d’influence sur les décisions d’un Président américain. Faux News est le meilleur vecteur de persuasion de Donald Trump : on ne compte plus les membres de son administration ou les protagonistes extérieurs à celle-ci qui se rendent sur la chaîne de Rupert Murdoch dans l’unique but de se faire entendre du Président. On l’a encore constaté dans le cas des droits de douane, où c’est l’interview de Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, par Maria Bartiromo qui fit comprendre à Donald Trump que la réaction des marchés obligataires n’était pas maîtrisable et qu’une récession était “probable“, selon le terme employé par le banquier. Et, comme souvent, la seule audience ciblée par ce dernier sur Fox News était le Président (notion désormais connue outre-Atlantique sous l’expression d’“audience of one“ ou “téléspectateur unique“).
Le quatrième pouvoir américain a oublié que le pouvoir médiatique ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.
IN. : Au fond, que nous dit cette situation de l’état de la démocratie américaine et du rôle des médias d’information aujourd’hui ?
C.L : Tout donne l’impression, aujourd’hui, que l’Amérique est engagée dans un glissement, non pas vers une dictature à la chinoise ou la russe, mais vers une forme moderne d’autocratie, ce qu’on appelle l’autoritarisme compétitif, un système dans lequel des partis légaux, y compris d’opposition, s’affrontent lors d’élections, mais où les abus du titulaire du pouvoir font systématiquement pencher la balance en sa faveur, parfois sans même avoir à modifier la Constitution. Il s’agit de l’équivalent politique du supplice des mille coupures. L’autoritarisme compétitif, que nous avons notamment vu à l’œuvre récemment, à des degrés divers, au Brésil, en Hongrie, en Inde, en Pologne, au Salvador, en Tunisie et en Turquie, n’est pas un régime immuable. Aucun ne l’est.
Aux Etats-Unis, le virage a commencé avant la première élection de Donald Trump, notablement en ce qui concerne les manipulations de Mitch McConnell au sujet des nominations à la Cour suprême. Dans le contexte actuel, et j’en ai donné de nombreux exemples en réponse à vos questions même si mon propos a été très incomplet, le quatrième pouvoir américain a oublié que le pouvoir médiatique ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Or, malgré tout, malgré la réserve des médias d’information, malgré la désinformation industrielle de l’Administration et malgré l’appareil de propagande à sa disposition, la cote de popularité de Donald Trump, après cent jours de mandat, est la plus basse de tous les Présidents américains depuis au moins 70 ans. Cela montre que des informations contraires à ses desseins parviennent en nombre aux citoyens.
Ponctuellement, la situation est donc rassurante. Dynamiquement, les multiples régressions que j’ai évoquées sont plus qu’inquiétantes. Mais rien n’est écrit ni perdu.