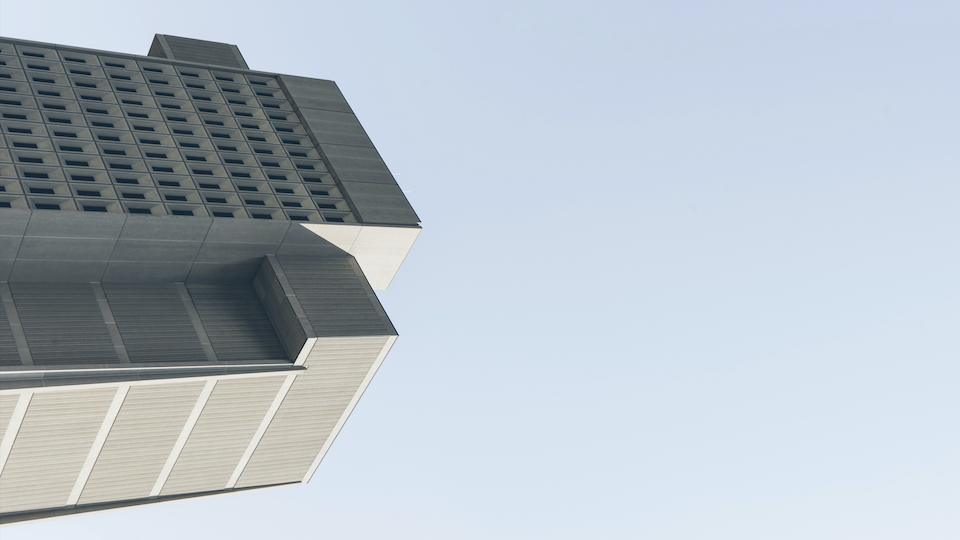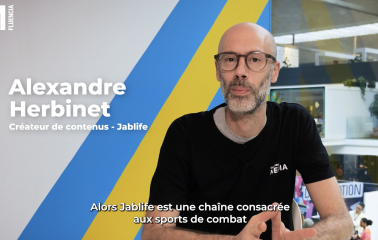Dévoilée le 1er juillet 2025, l’analyse des déclarations CoP 2024 met en lumière un paradoxe français. Les entreprises hexagonales sont nombreuses à afficher des politiques ambitieuses sur les grands sujets ESG — droits humains, environnement, gouvernance. Sur le papier, elles sont même souvent mieux-disantes que leurs homologues européennes. Mais dans les faits, elles peinent davantage à traduire ces engagements en actions concrètes, et encore plus à les incarner dans une dynamique de communication cohérente.
Prenons l’exemple de l’égalité des genres : 76 % des entreprises françaises déclarent mener des actions en la matière, contre 80 % dans le reste de l’Europe et 86 % dans le reste du monde. Pourtant, la France est l’un des pays les plus réglementés sur le sujet. Cette sous-déclaration n’est pas nécessairement signe d’inaction, mais peut traduire une difficulté à considérer la communication RSE comme un levier stratégique à part entière. Comme le suggère le communiqué, « la rigueur des exigences réglementaires peut conduire certaines entreprises à considérer qu’elles sont déjà conformes, sans ressentir le besoin de déclarer une action supplémentaire ».
Un reporting RSE encore trop cloisonné
Ce décalage entre engagement affiché et transparence effective se retrouve dans d’autres domaines. En matière de lutte contre la corruption, la France dispose d’un cadre robuste avec la loi Sapin 2. Pourtant, seules 42 % des entreprises déclarent former leurs salariés à ces enjeux, contre 61 % en Europe et 74 % dans le reste du monde. Elles ne sont que 4 % à former leurs partenaires de la chaîne de valeur. Des chiffres faibles qui interrogent moins la conformité juridique que la capacité à faire vivre une culture de l’intégrité — et à la valoriser publiquement.
Comme le rappelle Nils Pedersen, Délégué général du Pacte mondial de l’ONU – Réseau France, la Communication sur le Progrès « n’est pas une simple obligation de reporting, mais un référentiel universel de progrès continu ». C’est bien cette dimension structurante que les communicants et les directions RSE doivent aujourd’hui intégrer : la transparence ne se décrète pas, elle se construit et se communique.
Un besoin de narration plus incarnée
L’autre enseignement de l’étude, c’est le poids de l’ancienneté d’adhésion dans la maturité des pratiques. Les entreprises membres du Pacte mondial depuis plus de 16 ans sont 60 % à intégrer des critères environnementaux dans la rémunération variable de leurs cadres, contre 19 % pour les plus jeunes adhérentes. Même dynamique sur les actions concrètes : 95 % des entreprises les plus anciennes agissent sur le climat et l’énergie, contre 80 % seulement pour les nouveaux entrants. Autrement dit, les démarches durables se construisent dans la durée, mais leur reconnaissance dépend aussi de la manière dont elles sont racontées.
Dans un contexte de multiplication des labels, des normes et des exigences de double matérialité, la CoP peut devenir un levier de simplification et de lisibilité. Mais encore faut-il qu’elle soit intégrée dans une stratégie de communication globale, et non reléguée à une obligation déclarative parmi d’autres. Pour les grandes entreprises, notamment celles du SBF120, cette intégration est déjà en partie à l’œuvre. Elles sont 95 % à lier performance environnementale et rémunération des cadres, 100 % à mener des actions sur le climat, et 75 % à former tous leurs salariés à l’égalité femmes-hommes. Ces chiffres montrent que lorsque la gouvernance, les ressources et la culture interne suivent, la communication RSE devient un actif stratégique — et un différenciateur crédible.
À l’inverse, pour les PME ou les ETI, la CoP reste souvent perçue comme une charge administrative. Pourtant, elle offre un cadre clair, reconnu à l’échelle mondiale, pour structurer une narration ESG lisible. La difficulté n’est pas tant d’agir que de le formuler, de le documenter, de le transmettre — en un mot, d’en faire un récit. Et ce récit, aujourd’hui, est encore trop souvent absent des plans de communication.