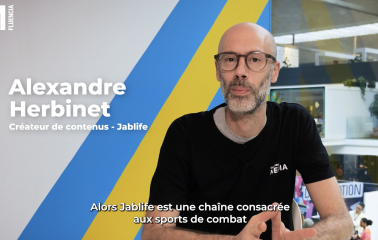Comment parvenir à « faire société » au sein d’une société elle-même de plus en plus fracturée par les inégalités de pouvoir d’achat ? Dans La Société de consommation, en 1970, Jean Baudrillard avait offert des éléments de réponse : « La consommation est une parole de la société contemporaine sur elle-même, la façon dont la société se parle. » Le sociologue aurait même pu ajouter : «… et la façon dont la société se vit, se ressent ».
« C’est quand on passe à la caisse qu’on voit ce qu’on vaut », témoigne l’un des Français interviewés dans le cadre de l’étude réalisée par 366.
Presque soixante-cinq ans après avoir été écrite, la phrase de Baudrillard prend une tonalité particulière. Car le pouvoir d’achat et les arbitrages de consommation surgissent comme des agents perturbateurs, un langage éloquent dans une nation qui veut faire société. Si 63% des Français estiment que « nous vivons dans une société injuste », ce sont 71% des Français CSP– qui expriment ce sentiment, selon l’étude « Françaises, Français, etc. », réalisée par 366 et le cabinet George (s), et publiée en novembre 2024. Déjà, en novembre 2023, l’étude « Classes moyennes en tension. Entre vie au rabais et aides publiques insuffisantes », que la Fondation Jean-Jaurès et Bona Fide produisaient, indiquait que « 53% des sondés déclarent aujourd’hui renoncer “très souvent” ou “assez souvent” à acheter certains produits ou certaines marques », quand « 32% le font de “temps en temps” ». Mais comment s’étonner ? « Le prix des produits alimentaires a augmenté en moyenne de 21% entre 2021 et 2023, celui de l’électricité de près de 70% entre 2018 et 2023, et le prix du litre de gasoil se situe aujourd’hui autour de 1,80 euro, alors qu’il était 1,40 euro en novembre 2018, lors du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes », résume le sondeur Jérôme Fourquet dans Métamorphoses françaises1.
L’amertume et la contrainte
D’où une amertume croissante : « C’est quand on passe à la caisse qu’on voit ce qu’on vaut », témoigne l’un des Français interviewés dans le cadre de l’étude réalisée par 366. Car le passage en caisse permet « d’évaluer sa situation sociale, et par là, se représenter l’état du pays lui-même », conclut l’étude. En clair, on « vaut » ce qu’on est en mesure d’acheter. Le 3 décembre 2024, une nouvelle étude de la Fondation Jean-Jaurès, À l’échelle humaine. Esquisse de portrait des Français, » – enfonçait le clou, révélant que « 55% des Français (versus 31% en 2023) déclarent avoir des difficultés pour joindre les deux bouts – c’est-à-dire d’assumer non pas le petit plaisir superflu ni la grosse dépense exceptionnelle, mais les seules dépenses courantes ».
Comment rassembler et faire vivre côte à côte ceux qui « peuvent acheter »… et ceux qui ne peuvent plus suivre ?
On touche là à « l’os » de la difficulté à réussir à faire société. Car comment rassembler et faire vivre côte à côte ceux qui « peuvent acheter »… et ceux qui ne peuvent plus suivre ? Aux classiques dépenses contraintes, s’est ajoutée la pression de nouvelles dépenses « socialement » contraintes, fruits de la mutation d’une société de consommation générant de nouveaux critères d’intégration sociale. Ce que l’influenceuse Nabilla aurait pu traduire par un cinglant : « Allô, quoi ?! T’as pas Internet, t’as pas de smartphone, t’as pas de smart TV et d’abonnement à Netflix ?! Tu vis sur la planète terre ou quoi ? »
Les deux tiers des classes défavorisées réalisent une « part importante de leurs achats » chez les hard-discounters… quand elles en ont encore la possibilité !
« J’ai même vu un cireur de chaussures à Mexico qui avait sa tablette ! », se souvient l’essayiste et philosophe Gilles Lipovetsky. « La société d’hyperconsommation a créé énormément d’objets jugés désormais nécessaires. Il y a à la fois plus de produits à acheter et moins de moyens d’y accéder. On comprend la blessure narcissique de ceux qui n’en ont pas les moyens et se sentent en permanence exclus », ajoute-t-il. Ce qui amène Gabriel Gaultier, président de Jésus & Gabriel et responsable du budget Marque Repère de Leclerc, à décrypter : « Les gens préfèrent couper dans leurs dépenses alimentaires que dans leur forfait téléphonique ou dans leur essence, car c’est le seul lien social qui les relie encore au monde. Quand tu es expatrié dans ton propre pays, tu es dé-territorialisé… »
Baisse, réduction, suppression, isolement
Pourtant, les Français ont multiplié les stratégies d’adaptation : baisse de leur épargne ; recours au marché de l’occasion – une enquête de l’Ifop, reprise par l’étude 2023 de la Fondation Jean-Jaurès révèle que « 11% de la population vend au moins une fois par mois des objets et ou des vêtements via des plateformes » ; suppression progressive de l’achat de produits secondaires comme les adoucissants, et enfin recours aux hard-discounters comme Lidl, Netto, Aldi, Action (marque préférée des Français en 2023), ou encore Normal, MaxiBazar… En 2023, toujours selon l’étude de la Fondation Jean-Jaurès, 49% de nos concitoyens y ont effectué une « part importante » de leurs achats de produits alimentaires et d’entretien » et même de babioles, car dans un climat anxiogène, il est précieux de pouvoir s’offrir une parenthèse de légèreté avec un agenda pailleté à 0,99 euro chez Normal ou un mini-cactus en plastique à 3,99 euros chez MaxiBazar.
Mais si, selon les chiffres, les deux tiers des classes défavorisées (64%) réalisent une « part importante de leurs achats » chez ces hard-discounters (source Jean Jaurès), c’est quand elles en ont encore la possibilité ! En 2023, en effet, l’effet de « descendeur social » a vu, faute de moyens financiers, ces catégories défavorisées les déserter progressivement… pour être prises en charge par les ONG. Un affaiblissement supplémentaire du lien social qui atteint aussi ceux qui n’ont plus les moyens d’accepter une invitation à dîner parce qu’il faudra la rendre, d’aller chez le coiffeur, au restaurant, au cinéma, ou de prendre des vacances chaque été. Au sentiment de déclassement s’ajoute l’isolement social.
Une anxiété « trans-classe » qui pose question
D’où la question qui s’impose : comment en est-on arrivé là ? Dès la fin de l’année 2021, le pouvoir d’achat a surgi au premier rang de la hiérarchie des préoccupations des Français – via une hausse des prix de 0,5% en 2020 et de 1,6% en 2021 – éclipsant largement les enjeux climatiques. Au point de figurer « à hauteur des attentes de 45% des votants lors de la présidentielle de 2022 », révèle l’étude de la Fondation Jean-Jaurès Entre difficultés à boucler les fins de mois et peur d’un « grand déclassement » : Comment le pouvoir d’achat s’est imposé comme la préoccupation n°1 des Français, publiée le 25 juin 2024.
L’occasion de découvrir une bascule inattendue. L’étude révélait que « cette préoccupation du pouvoir d’achat est désormais “trans-classe”. Elle est citée par 40% des personnes qui se définissent comme non privilégiées, 41% de ceux qui se jugent privilégiés et 45% qui estiment appartenir aux classes moyennes. » Président d’Australie/GAD, l’agence responsable du budget U, Gilles Masson confirme : « On voit cette préoccupation s’élargir et s’étendre aux classes moyennes aisées et supérieures. D’un côté, cela unifie le paysage social qui n’apparaît plus aussi fracturé, mais de l’autre, ça “dit” aussi le durcissement de l’aspect social. » Conséquence directe de l’annonce des plans sociaux de Michelin, Auchan, Valéo, Arcelor… cette préoccupation du pouvoir d’achat coexiste depuis quelques semaines avec celle d’une hausse du chômage.
De quoi amener certains à douter à haute voix des chances de « faire société », sauf à en partager les mêmes frustrations. « Quand on est habitué à vivre avec pas grand-chose, la moindre augmentation tourne à la catastrophe », constate Gabriel Gaultier, président de Jésus & Gabriel. « Le fossé est de plus en plus large entre “ceux qui ont les moyens” et “ceux qui ne l’ont pas”. Dans ce contexte, le vivre-ensemble apparaît comme le foutage de gueule de “la France d’en haut” parce que si les gens n’ont pas les moyens de vivre, ça ne signifie rien ! »
Mais d’où, aussi, le succès foudroyant des produits de marques distributeurs (les fameuses MDD : Marque Repère chez Leclerc, Reflets de France, Simply chez Auchan, Bio chez Carrefour, Paquito ou Monique Renou chez Intermarché), « En France, 70% des chariots sont désormais un mélange de marques et de MDD », rappelle Emily Mayer, directrice des études de l’institut Circana, dans Le Parisien du 11 décembre 2024. « La période d’hyperinflation des années 2022 et 2023 y est pour quelque chose : ces articles sont en moyenne 35% moins chers et leur part de marché est passée de 33,1% à 36,1% en l’espace de trois ans. »
Les efforts effectués sur la qualité des produits, avec la généralisation progressive du Nutri-score sur les emballages depuis 2017 et la révision des recettes a fini par payer.
Le poison lent et silencieux de l’inflation
Un phénomène qui doit beaucoup à l’angoisse sur le pouvoir d’achat. Pourtant, la hausse des prix s’est stabilisée avec une augmentation de 1,3% en novembre et de 1,2% en octobre 2024 versus 2023. Mais ce serait oublier que l’inflation, si elle se matérialise immédiatement par une valse des étiquettes, peut se révéler un poison lent et silencieux. Alors que le mauvais génie s’en est retourné dans sa bouteille, les prix, eux, ne sont pas redescendus pour autant. En amont, les industriels ont eux-mêmes subi l’impact d’une hausse des matières premières, souvent répercutée sur leurs prix. « Le prix du cabillaud a flambé récemment parce que ce poisson est de plus en plus populaire, mais que la ressource est limitée. Nous vivons sur une planète à bout de souffle. », intervient Eric Delannoy, VP et Managing Partner de WNP (groupe Anomaly Alliance), responsable des budgets Panzani et des plats Marie. D’où le choix, pour certains industriels, de couper drastiquement dans leurs investissements bruts publicitaires comme Ferrero (-47%), Nestlé (-21%), Mondelez (-12%), Lindt (-9%) (source Kantar Média) en 2023, au risque de perdre le lien avec leurs consommateurs tout en laissant le champ libre aux MDD. « Stable pendant quinze ans, le prix des œufs et des pâtes a littéralement explosé de plus de 20% et ne retrouvera pas son niveau de 2020. Certes, les salaires ont suivi, mais avec retard. Et le sentiment d’une perte de pouvoir d’achat demeure prégnant », confirme Le Monde le 8 novembre2024.
Le sondage d’Ifop/Fiducial en mars 2024 relève que « 92% des Français » continuent de se déclarer « inquiets » à propos de l’inflation. À ce titre, le pouvoir d’achat figure aujourd’hui comme « leur préoccupation principale ». Incompréhensible ? Pas tant que cela. « Il s’agit de tout le problème des “biais de perception” que ne prend pas en compte l’Insee, décrypte Philippe Moati, co–fondateur de L’Observatoire de la Consommation Responsable (ObSoCo). « Les individus voient d’abord ce qu’ils ont immédiatement sous les yeux et ce qui est primordial pour eux. Or, l’inflation s’est révélée particulièrement sévère pour l’alimentaire avec une montée en flèche des prix de 11,9% (et un pic à 16% au printemps) en 2023. Sur les deux années 2022 et 2023, la hausse globale a atteint 20%. De son côté, le prix du litre d’essence a frôlé les 2 euros. Face à cette envolée, le pouvoir d’achat global, qui intègre les revenus du patrimoine, n’a progressé que de 0,3%.»
Non seulement, les caddys sont moins remplis, mais la qualité nutritive de ce que les Français achètent est perçue parfois comme dégradée par les consommateurs interrogés dans les études. « Je me demande jusqu’où ça va aller et si je vais pouvoir continuer à me nourrir correctement », « Je n’achète plus de marques plaisirs, comme les chocolats Kinder, la viande Charal, le lait Lactel. Je ne prends que des sous-marques », « Je reconnais que je fais mes courses d’après les promotions existantes », lit-on dans les verbatims de l’étude Classes Moyennes en tension de la Fondation Jean-Jaurès. Mais ce sentiment de déclassement et de qualité moindre faiblit. Longtemps, l’attrait pour les MDD, commandées directement à des industriels par les grandes enseignes, a été lié au prix. Mais les efforts effectués sur la qualité des produits, avec la généralisation progressive du Nutri-score sur les emballages depuis 2017 et la révision des recettes a fini également par payer. De gré ou de force.
Dédramatiser cette vie absurde
La stratégie de communication d’une grande enseigne comme Intermarché, qui a usé, avec son agence Romance (Omnicom), de l’humour et du second degré pour dédramatiser les tensions sur le pouvoir d’achat, a également joué un rôle déterminant pendant la séquence inflationniste. « L’objectif de la campagne était de ne pas paupériser davantage la représentation des consommateurs précaires, quand tous décrivaient déjà la déferlante d’un “mars rouge” au pic du choc inflationniste », indique Christophe Lichtenstein, co–fondateur et président de Romance. D’où son idée de mettre en scène un univers lunaire : « L’idée créative a consisté à mettre en scène la vie absurde des Français, « un monde dans lequel les produits alimentaires sont devenus des produits de luxe inaccessibles. Dans le même temps, Intermarché a d’ailleurs surenchéri en proposant un panier “anti-inflation” composé de produits frais de qualité et à prix bas. Viande, poisson, fruits et légumes. Quand certaines enseignes vendaient des paniers composés essentiellement de pâtes et de riz… », raconte-t-il.
La même année, l’enseigne et son agence ont franchi une étape supplémentaire dans le « faire société » via la campagne « Ça s’éclaircit devant », qu’évoque Raphaël Llorca dans Le Roman national des marques2. Docker à Sète, Pierrot en a assez de retrouver vide la gamelle qu’il prépare chaque soir pour sa pause-déjeuner. Il décide de piéger son voleur… découvre qu’il s’agit de Sam, un jeune collègue désargenté, et finit par préparer deux gamelles, chacune à leur nom respectif. « Mieux qu’une conférence de presse à Bercy, ou une interview de la Première ministre dans la presse écrite, on ne saurait mieux raconter la solidarité des gens en temps de crise », conclut Raphaël Llorca.
Alors que les marques nationales brillaient par leur silence, la grande distribution a su saisir l’occasion de s’afficher comme le chevalier blanc volant au secours du pouvoir d’achat de ses consommateurs.
Alors que les marques nationales brillaient par leur silence – faute de pouvoir tenir un discours prix compétitif face aux marques distributeurs la grande distribution a saisi ainsi l’occasion de s’afficher comme le chevalier blanc volant au secours du pouvoir d’achat de ses consommateurs. « Contre l’inflation, on bloque », affirme alors E.Leclerc avec sa campagne signée BETC/Havas, tandis que Carrefour promet avec Publicis : « On a décidé d’augmenter la baisse des prix » et que U s’engage sur « Des valeurs fortes et des prix bas ».De son côté, Lidl avec Marcel : « Mieux qu’un panier anti-inflation, un supermarché anti-inflation », face à un Auchan qui propose : « Découvrez toutes nos solutions anti-inflation pro plaisir ». Certaines, à l’image de Carrefour et d’Intermarché vont même plus loin, en se livrant à un « name & shame » sur les industriels pratiquant une skrinkflation décomplexée, à l’image de plusieurs marques (Knorr, Ben & Jerry’s, Magnum…) du géant de l’agro-alimentaire Unilever.
Seul, Aldi, fort de son positionnement prix, choisit de tenir un discours gourmandise et qualité. « Nous n’avons rien à prouver », estime Anne-Marie Gaultier, directrice du marketing et de la communication d’Aldi. « 90% de notre offre est constituée de marques de distributeurs avec une offre délibérément restreinte à 1800 références, là où le chiffre tombe à 40% chez les autres distributeurs avec de 15000 à 20000 références. Et chaque mercredi et samedi, nous offrons l’opportunité d’achats “plaisirs” avec des brosses soufflantes, des cocottes en fonte d’excellente qualité, aux prix cassés. » Pour que les consommateurs soient rassurés sur la qualité des produits, l’enseigne est même allée jusqu’à mettre en place un « Club des Goûteurs », composé de 2000 consommateurs en 2024, sélectionnés pour tester et évaluer les produits des marques Aldi.
Mais la société française continue d’avoir des bleus à l’âme. Comme le révèle l’étude de 366, s’appuyant sur un sondage d’Odoxa d’avril 2024, elle se décrit elle-même comme de plus en plus « archipélisée » à hauteur de 88%. « Autrefois, on pouvait vivre avec très peu »,décrypte Gilles Lipovetsky. « Maintenant, tout est cher avec une montée en gamme généralisée, et 31% des Français n’ont plus que 100 euros sur leur compte le 10 du mois. Le consumérisme qui était censé offrir le bonheur, a mis en revanche une pression accrue et insupportable pour certains. » Même si, là encore, la réactivité des enseignes de distribution et de leurs agences pourraient en faire les grandes gagnantes de ce défi du faire société. Quitte à prendre le risque d’affronter les industriels sur leur propre terrain.
1. Métamorphoses françaises. État de la France en infographies et en images, Jérôme Fourquet, Le Seuil, 2024.
2. Le Roman national des marques. Le nouvel imaginaire français, Raphaël Llorca, éditions de L’Aube, 2023.