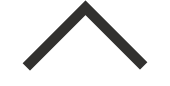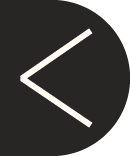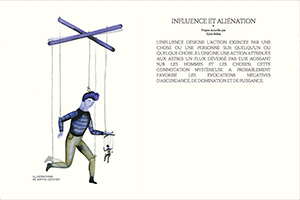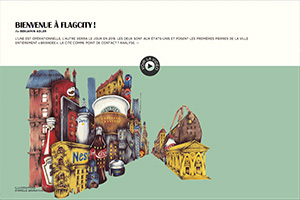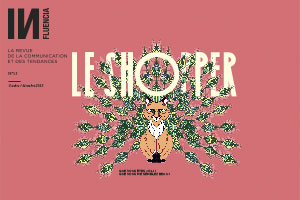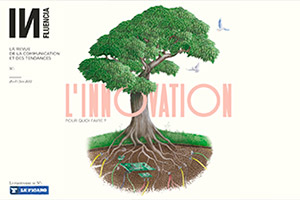|
« Je me demande
si les connaissances
vont pouvoir cohabiter
avec les croyances »
Interview par Isabelle Musnik
Comprendre la data, c’est comprendre ses origines, et aussi ses créateurs, les hommes de science. INfluencia donne la parole à l’un d’entre eux, Etienne Klein, physicien, docteur en philosophie des sciences, professeur à l’Ecole Centrale de Paris et directeur du Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA (LARSIM). Il a également publié plusieurs ouvrages sur la physique et la gestion du temps.
|
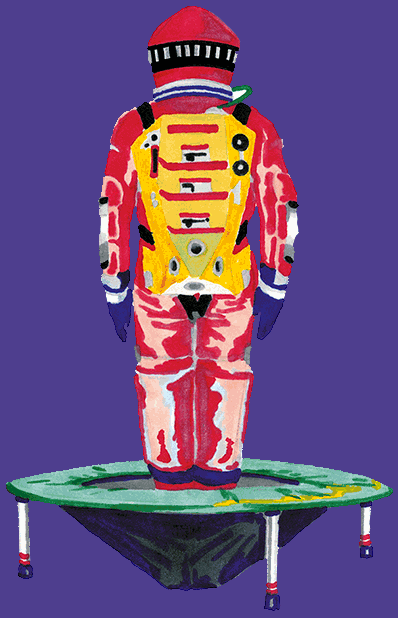
ILLUSTRATIONS
de maxime mouysset
de maxime mouysset

Portrait de Etienne Klein
par Maxime Mouysset
Le mot « évaluation »
est venu agiter et intégralement coloniser
le monde de la recherche
et de l’enseignement
supérieur

On met des
chiffres partout,
qui viennent déposer
comme des cendres
sur le réel

IÑfluencia Même si la science demeure le socle de nos sociétés, elle est aujourd'hui questionnée et critiquée comme jamais. Pourquoi ?
Etienne Klein Le prestige de la science a longtemps tenu au fait qu’on lui conférait le pouvoir symbolique de proposer un point de vue surplombant sur le monde : assise sur un refuge neutre et haut-placé, sûre d’elle-même, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel, tout près de la vérité et hors de l’humain. Cette image est aujourd’hui dépassée. Nous avons compris que la science n’est pas un nuage lévitant calmement au-dessus de nos têtes : elle pleut littéralement sur nous. Tout se passe comme si ses discours, ses réalisations et ses avancées devaient constamment être interrogées, systématiquement mis en ballotage.
La puissance de dévoilement de la science et l’impact des technosciences sur les modes de vie provoquent désormais des réactions de résistance, d’ordre culturel, social, politique, philosophique. Ces réactions peuvent être le désir de réaffirmer son autonomie face à un processus qui semble nous échapper ; ou bien l’envie de défendre des idéaux alternatifs contre la menace d’un modèle unique de compréhension ou de développement ; ou bien encore la volonté de rendre sa pertinence au débat démocratique quand la complexité des problèmes tend à le confisquer au profit des seuls experts.
À ce propos, regardez comment le sens du dicton « On n’arrête pas le progrès » s’est modifié en seulement quelques décennies. Lorsque j’étais jeune, il y avait quelque chose de joyeux dans ce « on n’arrête pas le progrès ». C’était une salutation enthousiaste adressée au futur qui semblait moralement interdire qu’on pût souhaiter stopper la marche du progrès. Or aujourd’hui, elle signifie plutôt qu’il n’est dans le pouvoir d’aucun humain de l’arrêter, comme si le progrès s’était émancipé de nos propres désirs et échappait à toute maîtrise. Cela dit assez bien la vitesse à laquelle notre rapport au progrès a changé. En fait, les idées d’innovation et de progrès se sont comme séparées l’une de l’autre.
C’est pourquoi notre rapport à la science est devenu foncièrement ambivalent. Cela peut se voir sous forme condensée en mettant l’une en face de l’autre les deux réalités suivantes.
D’une part, la science nous semble constituer, en tant qu’idéalité (c’est-à-dire en tant que démarche de connaissance d’un type très particulier qui permet d’accéder à des connaissances qu’aucune autre démarche ne peut produire), le fondement officiel de notre société, censé remplacer l’ancien socle religieux. Nous ne sommes certes pas gouvernés par la science elle-même, mais au nom de quelque chose qui a à voir avec elle. C’est ainsi que dans toutes les sphères de notre vie, nous nous trouvons désormais soumis à une multitude d’évaluations, lesquelles ne sont pas prononcées par des prédicateurs religieux ou des idéologues illuminés : elles se présentent désormais comme de simples jugements d’« experts », c’est-à-dire sont censées être effectuées au nom de savoirs et de compétences de type scientifique, et donc, à ce titre, impartiaux et objectifs.
Mais d’autre part - et c’est ce qui fait toute l’ambiguïté de l’affaire -, la science, dans sa réalité pratique, est questionnée comme jamais, contestée, remise en cause, voire marginalisée. Elle est à la fois objet de désaffection de la part des étudiants (les jeunes, dans presque tous les pays développés, se destinent de moins en moins aux études scientifiques), de méconnaissance effective dans la société (nous devons bien reconnaître que collectivement, nous ne savons pas trop bien ce qu’est la radioactivité ou ce qu’implique la théorie de la relativité et ce que dirait l’équation E=mc2 si elle pouvait parler), et, enfin et surtout, elle subit toutes sortes d’attaques, d’ordre philosophique ou politique.
Dans ce contexte, les messages en provenance de la science sont de plus en plus difficiles à transmettre. De façon générale, les discours subtils, prudents, ceux qui font des plis, se trouvent exclus des grands médias. De sorte que l’engouement remplace de plus en plus souvent le raisonnement, la conviction intime ou le goût spontané compte davantage qu’une argumentation solide ou une critique rigoureuse. Dans un tel système, je me demande si les connaissances pourront durablement s’imposer face aux croyances. D’autant que sur Internet, par exemple, ceux qui savent se montrent moins actifs et moins prosélytes que ceux qui croient…
Bien sûr, il serait trop facile de n’accuser que les médias dans cette affaire, mais tout de même : les formes modernes de la communication se transforment sous nos yeux en une vaste polyphonie de l’insignifiance. Elles produisent une sorte de magma informel que nul message élaboré, construit, raffiné, ne parvient plus à transpercer. L’épaisseur et la densité de ce magma sont telles que la science ne nous « touche » plus : non pas au sens où elle nous serait indifférente, mais parce que, noyée, enfouie sous le flot du reste, elle ne parviendrait même plus à entrer en contact avec nous, à nous atteindre.
IÑ Aujourd’hui, la donnée est reine, et parfois à la limite de la dictature. Ne va-t-on pas accuser la science d'être coupable de cette prolifération de données ?
EK Sans doute, et on le fait déjà. Ce fut le cas notamment lors de la crise financière : on a accusé les mathématiciens d’en être les vrais responsables parce qu’ils avaient développé des algorithmes dont ils n’avaient guère la maîtrise. En fait, c’est l’idée même de progrès qui se trouve, à juste titre, problématisée. Derrière elle, on trouvait la conviction qu’on peut relativiser, le « négatif ». Voire que le « pur négatif » n’existe pas, car il n’est jamais que le ferment du meilleur, c’est-à-dire ce sur quoi on va pouvoir agir pour le sortir de lui-même. Se déclarer progressiste ou moderne, c’était donc croire que la négativité contient une énergie motrice qui peut être utilisée pour la transformer en son contraire. Or, cette espérance s’est ternie au cours du XXe siècle, si dégrisant à certains égards. Il nous a même fait entrer dans « l’après » de cette idée, dans une phase de critiques et de doutes. Certains parlent de « postmodernité » : la postmodernité, ce serait en quelque sorte la modernité moins l’illusion. L’illusion dont il est ici question était celle de la possibilité d’un état final et définitif de la société, où il n’y aurait plus rien à faire d’autre que de continuer, de répéter, sans avoir à déployer autant d’efforts que ceux consentis pour parvenir à cet état. Or, nous constatons, nous, que le nombre de problèmes ne diminue pas à mesure que nous avançons. Dans ce nouveau cadre, le progrès n’est plus appréhendé comme un pur soulagement, mais plutôt comme un souci, une inquiétude diffuse.
IÑ C'est ce qui explique que nos liens avec la science se soient distendus ?
EK Peut-être, mais pas seulement : une anagramme de l'« idée de progrès » se trouve être le « degré d’espoir ». Il ne s’agit bien sûr que d’un hasard, auquel on peut toutefois tenter de trouver un sens : pour que la foi dans l’idée de progrès se réactive et redevienne sincère, il faudrait construire une sorte de filiation intellectuelle et affective entre l’avenir et nous. Cela suppose que nous fassions l’effort préalable de configurer le futur, de le représenter. Car lorsqu’il est laissé en jachère intellectuelle, ce sont les peurs plutôt que les désirs qui l’investissent : avenir et espoir ne sont plus associés. Il ne s’agit pas de se laisser séduire par des attentes purement utopiques, mais d’empêcher l’horizon d’attente de fuir. Les utopies, elles, ne peuvent que désespérer l’action, car faute d’ancrage dans l’expérience en cours, elles sont incapables de formuler un chemin praticable dirigé vers les idéaux qu’elles situent toujours ailleurs et très loin de nous.
Les gens de ma génération (je suis né en 1958) se souviennent que pendant leur adolescence, ils étaient nourris par des hebdomadaires, tels « Pilote » ou « Tintin », qui leur expliquaient comment ce serait en l’an 2000, comment on y travaillerait, s’y déplacerait, s’y nourrirait, etc. Évidemment, ces anticipations se sont révélées fausses pour la plupart, mais il n’empêche que le futur était là, sous nos yeux ! Il n’était pas pensé comme un pur néant, mais présenté comme un moment qui aurait effectivement lieu. Cela suffisait à tracer des trajectoires, à dynamiser le temps que nous vivions en force historique. Aujourd’hui, quand on se risque à faire de la prospective, on se borne à 2025, c’est-à-dire à demain. Quid de 2050 ? Il faudrait davantage travailler à configurer notre futur.
IÑ On est dans une société complexe, où règne la data et où on veut à la fois tout savoir, tout complexifier et tout simplifier. Comment gérer ce paradoxe ?
EK On met en effet des chiffres partout, qui viennent déposer comme des cendres sur le réel. Permettez-moi de prendre exemple de l’activité des chercheurs. Aujourd’hui, les hommes de science écrivent. Ils ne cessent même presque jamais d’écrire : ils écrivent des articles scientifiques, mais aussi des projets à soumettre aux agences de financement, mais aussi des rapports pour les mêmes agences de financement sur les projets soumis par d’autres chercheurs, mais également des rapports aux agences de financement sur les recherches menées grâce aux subventions, mais encoredes rapports sur les rapports rendus par d’autres chercheurs sur les travaux subventionnés, et j’en passe… D’où vient que les scientifiques écrivent tant ? Les choses se sont passées à peu près partout de la même façon : les réformes successives de la gouvernance de la recherche ont transformé les chercheurs en gérants d’un capital qu’ils font fructifier en transmutant leurs articles en demande de subventions, leurs subventions en articles, et leurs articles en nouvelles demandes de subvention. Tous galopent sans jamais s’arrêter pour rester dans la course, d’où la croissance exponentielle de la logorrhée scientifique. Mais comment jauger la valeur de cette énorme production, de cette Big Data ? En l’évaluant, pardi. C’est ainsi que le mot « évaluation » est venu agiter et intégralement coloniser le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. On veut désormais tout évaluer : les enseignants, les professeurs, les chercheurs, les programmes de formation, les universités et même les agences d’évaluation, et bientôt - sans doute aussi - les agences qui évaluent les agences d’évaluation. Tout se passe comme si on avait peur de ce qui n’est pas mesuré ou – pire – de ce qui ne serait pas mesurable. Comme si on voulait tout formater, tout aplatir, tout mettre en grilles selon les critères des agences de notation.
IÑ « le temps est un aigle agile dans un temple », a écrit Robert Desnos, c'est un peu comme l'aigle ou le vautour qui dévore le foie de Prométhée qui repousse sans cesse. Alors si tout s'accélère, que peut-on faire ? La science a t-elle un rôle « philosophique » à jouer ?
EK Si la science est, comme je l’ai dit plus haut, la première victime d’une « crise de la patience », c’est qu’elle nous donne sans cesse des leçons de patience. Le boson de Higgs, qui a été découvert en 2012 au CERN, avait été prédit par des théoriciens en 1964. Il aura donc fallu 48 ans d’efforts, de recherches, d’engagements de la part de milliers de gens pour parvenir à le détecter. C’est un bel enseignement, non ? D’autant qu’aujourd’hui, constatant que nos agendas sont saturés, que le rythme social nous transforme en Turbo-Bécassines et en Cyber-Gédéons, nous nous exclamons, comme à bout de souffle : « le temps passe de plus en plus vite ! » Comme si le temps s’identifiait avec notre emploi du temps et n’avait rien d’autre à faire que d’épouser le rythme de nos activités. Comme si, surtout, la notion de vitesse lui était à l’évidence applicable. Mais pareille invocation d’une vitesse d’écoulement qu’aurait le temps est-elle seulement pertinente ? Nullement, puisqu’une vitesse est une dérivée par rapport… au temps. Parler d’une vitesse du temps n’a donc guère de sens, puisque cela supposerait de pouvoir exprimer la variation du rythme du temps par rapport à lui-même… Nous cédons à l’urgence, tout en sachant fort bien, au fond de nous-mêmes, que l’agitation n’est pas le plus court chemin vers la création. Dans une lettre qu’il adressa à son ami Le Corbusier, Fernand Léger, inquiet de tout voir devenir trop mobile, défendait l’idée que le travail véritable, celui par lequel les choses importantes se font vraiment, est imprégné de lenteur et de recul : « La vie sérieuse marche à trois kilomètres à l’heure, c’est-à-dire au pas d’une vache sur une route. Le danger d’une vie comme la nôtre, c’est de croire aux 1 200 kilomètres à l’heure de l’avion et que ce truc-là change quoi que ce soit à la création soit artistique, soit scientifique. Elle est contrainte par la règle des grandes forces naturelles : un arbre met dix ans à devenir un arbre. Et un grand tableau ? Et un beau roman ? Et une belle invention ? Du trois kilomètres à l’heure, Monsieur, et encore ! ». En réalité, je pense que nous sommes moins les victimes d’une prétendue accélération du temps que d’une superposition des présents : en même temps que nous travaillons, nous regardons les écrans de nos téléphones portables, écoutons la radio et pensons à autre chose encore…
IÑ finalement qui va l'emporter? Les « sachants » ou les croyants ?
EKJe ne suis pas devin, mais il me semble qu’il se produit un changement de climat culturel. Aujourd’hui, notre société semble en effet parcourue par deux courants de pensée qui semblent contradictoires. D’une part, on y trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière, bref une attitude de défiance généralisée. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d’être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité existe-t-elle, se demande-t-on ? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle ? Ce qui est troublant, c’est que ces deux attitudes, l’attachement à la véracité et la suspicion à l’égard de la vérité, qui devraient s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher au sein de la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait des vérités sûres1.
Le fait que l’exigence de véracité et le déni de vérité aillent de pair ne veut toutefois pas dire que ces deux attitudes fassent bon ménage. Car si vous ne croyez pas à l’existence de la vérité, quelle cause votre désir de véracité servira-t-il ? Ou – pour le dire autrement – en recherchant la véracité, à quelle vérité êtes-vous censé être fidèle ? Il ne s’agit pas là d’une difficulté seulement abstraite ni simplement d’un paradoxe : cette situation entraîne des conséquences concrètes dans la cité réelle et vient nous avertir qu’il y a un risque que certaines de nos activités intellectuelles en viennent à se désintégrer.
Grâce à la sympathie intellectuelle quasi spontanée dont elles bénéficient, les doctrines relativistes contribuent à une forme d’illettrisme scientifique d’autant plus pernicieuse que celle-ci avance inconsciente d’elle-même. Au demeurant, pourquoi ces doctrines séduisent-elles tant ? Sans doute parce que, interprétées comme une remise en cause des prétentions de la science, un antidote à l’arrogance des scientifiques, elles semblent nourrir un soupçon qui se généralise, celui de l’imposture : « Finalement, (en science comme ailleurs) tout est relatif. ». Ce soupçon légitime une forme de désinvolture intellectuelle, de paresse systématique, et procure même une sorte de soulagement : dès lors que la science produit des discours qui n’auraient pas plus de véracité que les autres, pourquoi faudrait-il s’échiner à vouloir les comprendre, à se les approprier ? Il fait beau : n’a-t-on pas mieux à faire qu’apprendre sérieusement la physique, la biologie ou les statistiques ?
* « Il était sept fois la révolution. Albert Einstein et les autres », « Le Facteur temps ne sonne jamais deux fois », « Anagrammes renversantes, ou le sens caché du monde », « En cherchant Majorana, le physicien absolu » (Editions des Equateurs, 2013)

|
Isabelle Musnik
Directrice des contenus et de la rédaction
|

La science n’est pas
un nuage lévitant calmement
au-dessus de nos têtes :
elle pleut littéralement sur nous

Nous ne sommes certes pas
gouvernés par la science
elle-même, mais au nom
de quelque chose qui
a à voir avec elle

13

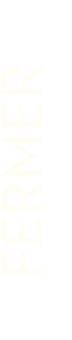
SOMMAIRE Articles gratuits
S'ABONNER À LA REVUE INFLUENCIA
Je peux accéder immédiatement à la revue digitale et recevrai mes revues papier par courrier.
Je pourrai accéder à la revue digitale après réception du paiement et recevrai mes revues papier par courrier.
NEWSLETTER INFLUENCIA
S'abonner à la newsletter INfluencia
CONSULTER LES REVUES INFLUENCIA
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI UN COMPTE (JE SUIS ABONNÉ.E OU J'AI ACHETÉ CE N°)
JE SOUHAITE M'ABONNER POUR 1 AN OU ACHETER UN/PLUSIEURS N° SPÉCIFIQUE.S DE LA REVUE
Accédez immédiatement à votre Revue en version digitale. Puis recevez la.les Revue(s) papier par courrier (en cas d'achat ou de souscription à l'offre complète Papier + Digital)
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
E-mail
| JE M'ABONNE, ME REABONNE OU COMMANDE UN N° | × |
| JE CONSULTE GRATUITEMENT LA REVUE | × |